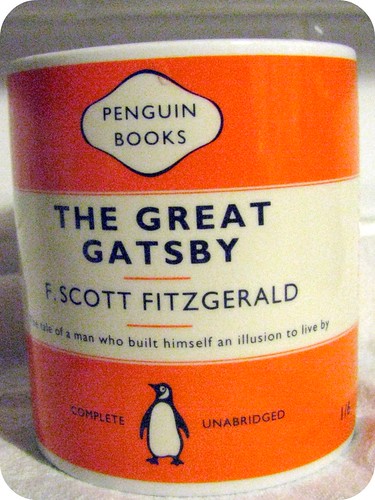les émigrants
Sebald est un écrivain allemand, né en 1944. Il a quitté l’Allemagne à la fin de ses études, pour la Grande-Bretagne, où il est resté jusqu’à la fin de sa vie, enseignant la littérature et la traduction.
Les émigrants, sous-titré Quatre récits illustrés, paru en allemand en 92 (et traduit en français 7 ans plus tard), est ce que Sebald lui-même nomme de la “prose narrative”, ce qui est une façon de botter en touche quand à la question de la véracité ou non de ce qu’il y raconte.
Les quatre portraits qu’il nous dresse sont ceux de quatre hommes qui, ayant quitté leur pays dans leur enfance ou leur jeunesse, se retrouvent pour toujours comme figés, bloqués, dans ce mouvement, cette attitude, celle du départ.
Des émigrants, et non pas des émigrés. Des hommes contraints de laisser derrière eux leurs repères, leur univers, leur langue, et qui, jusqu’à la fin de leur vie, et ce, quelle que soit leur réussite sociale, leur “intégration” dans le pays qui les accueille, sont des hommes blessés, amputés d’une partie substantielle de leur vie.
Ces portraits sont présentés comme des enquêtes, menées par l’auteur, sur des personnes qu’il rencontre au hasard, comme le propriétaire d’un logement qu’il souhaite louer, ou un peintre dans l’atelier duquel il pénètre au cours de ses pérégrinations dans le quartier portuaire de Manchester, ou sur des personnes qui lui ont été proches : un grand-oncle, son instituteur. L’auteur recueille leur témoignage, et collecte toutes sortes de documents : agendas, photographies, lettres… afin de nous présenter un portrait de ces émigrants, qui dresse, “en creux”, celui de son émigration à lui.
Jamais, à aucun moment, Sebald n’affirme qu’il s’agisse de “vrais” personnages, ni de leur vraie histoire; mais à la lecture on peut penser à Carrère et à ses Autres vies que la mienne : comme Carrère, mais avec un talent littéraire, un soin du style bien supérieurs, Sebald semble nous inviter dans l’existence de personnages qui pourraient être nos voisins, nos logeurs, nos instituteurs… Seul un personnage récurrent, le “chasseur de papillon”, qui est présent comme un figurant dans chacun des récits, peut nous laisser penser que la part de fiction, de création, est peut-être plus importante qu’il n’y parait.
Et toujours présente en filigrane, jamais réellement évoquée, l’holocauste, dont la prémonition poussa tant de juifs d’Europe, d’Allemagne en particulier, à émigrer, à tout laisser derrière eux.
Sebald était le fils d’un officier de l’armée allemande, et son œuvre est marquée par cette guerre, par le silence que la génération de son père lui opposa quand à cette période.
Un livre très fort, très bien écrit, très bien traduit surtout (pour lire pas mal de romans nordiques traduits à la truelle ou au “google translate”, je peux dire qu’on s’aperçoit immédiatement de la différence), et, j’ose dire, salutaire, en ces temps où “l’identité nationale” est la vertu suprême, qui a remplacée celle, chère à mon cœur, de cosmopolitisme.
Un livre cosmopolite, donc. (et je ne peux imaginer de plus grande qualité que celle-ci…)